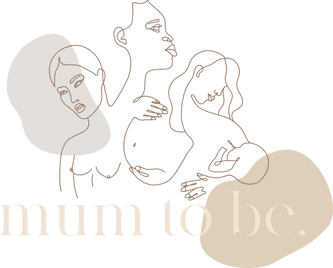Le sommeil et l'allaitement
Certaines croyances ont encore la dent dure afin d’y voir plus clair, je souhaite partager avec vous des idées reçues fréquemment entendues concernant le sommeil et l’allaitement. Cela vous permettra de vous forger votre propre opinion !
L’affirmation selon laquelle les enfants nourris au biberon dorment mieux que les enfants allaités est répandue.
Mais sais-tu que le contact corporel, favorisé par l’allaitement, apaise le nouveau-né, induisant ainsi détente et sommeil ?
Il est souvent dit qu’arrêter d’allaiter pourrait améliorer le sommeil de la maman.
Or, plusieurs études ont démontré que c’était identique, voire le contraire ! En 2014, une étude a révélé que les femmes qui allaitent exclusivement un mois après l’accouchement avaient un sommeil nocturne de 30 min en moyenne de plus que les femmes qui utilisent une préparation pour nourrissons ! Et ce n’est pas l’unique résultat que j’ai pu retrouver !
Quant à l’affirmation selon laquelle l’allaitement fatigue davantage que l’alimentation au biberon avec une Préparation pour Nourrissons (PPN) :
mes recherches révèlent une observation indéniable. L’évaluation de la fatigue pour les mères réalisant une alimentation mixte (c'est-à-dire celles qui allaitaient et donnaient une Préparation Pour Nourrissons) montrait des scores plus élevés à 1 et 2 mois, et un score égal de 4 à 6 mois.
On peut donc en conclure que le stress et la fatigue sont retrouvés quel que soit le mode d'alimentation de l’enfant !
Une astuce à retenir:
Durant les premiers mois de vie, le sommeil et la sensation de satiété sont très étroitement liés. Si votre tout-petit se réveille très fréquemment au cours de la nuit, il est utile de vérifier, auprès d’une professionnelle formée en allaitement, l’efficacité du transfert de lait.
Soyons bien d’accord : il est naturel qu’un bébé se réveille à plusieurs reprises durant les premiers mois, mais si c’est toutes les heures (hors période de “pointe”), tous les soirs il a sûrement quelque chose à creuser de ce côté-là.
Une information à connaître pour mieux comprendre les mécanismes de l’allaitement et du sommeil
Les hormones ont un rôle non négligeable pour comprendre les mécanismes en jeu :
- Du côté de votre bébé : le taux de mélatonine et de tryptophane contenu dans le lait humain est plus élevé la nuit pour favoriser le sommeil et la restauration cellulaire.
- De votre côté : la libération de dopamine favorisée par la prolactine et l'ocytocine agis directement sur les récepteurs cérébraux avec un effet anxiolytique et sédatif qui facilite le ré-endormissement lors des tétées nocturnes
En explorant ces idées reçues, j’espère que ces informations vous ont éclairé sur ces croyances. Elles vous offriront des clés pour mieux comprendre et accompagner cette période importante pour votre tout-petit.
L'éveil au Monde, Pope Henessy Court Road, Port Louis 00000, Maurice