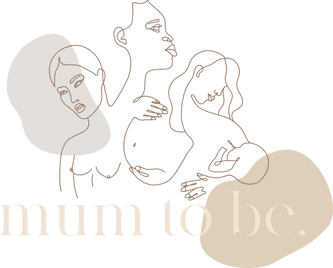Baby blues et dépression post-partum, quelles différences ?
15 février 2024
Heureusement les langues se délient et cela laisse la place à une parentalité plus nuancée en couleur.
La naissance d’un enfant notamment n’est plus perçue comme forcément « toute rose » (ou « toute bleu »).
Avec internet, il est d’autant plus important de bien trier les informations, pour éviter soit de banaliser, soit de paniquer. Une des questions qui inquiète souvent les futurs et jeunes parents est de savoir comment différencier
un baby blues « normal » d’une dépression post-partum.
Voilà quelques indices à garder en tête :
Baby blues
- Dans les 10 premiers jours suivant la naissance, avec un pic entre le 3ème et 5ème jour
- 50% à 70% des femmes
- Hypersensibilité (crises de larmes sans véritable raison, irritabilité, anxiété, tristesse) ; oubli et confusion ; sautes d’humeur ; sentiment de dévalorisation
- Humeur fluctuante dans la journée et l’hypersensibilité se manifeste sur de courtes périodes
Dépression post-partum des mères
- Débute souvent pendant la grossesse (mais rarement remarquée, donc soyez attentifs) avec une intensification dès le premier mois après la naissance du bébé et notamment un pic entre la 6ème et 12ème semaine. Peut durer jusqu’à 16 mois après la naissance
- 10% à 18% des femmes (mais sous-évalué par les professionnels et les mamans elles-mêmes car les symptômes sont souvent mis sur le compte de la fatigue « parce qu’on a un bébé » et la honte, la culpabilité de se sentir mal dans cette période «de grand bonheur »)
- Épuisement mental et physique ; manque de motivation ; sentiment de vide ; malaise avec les contacts physiques ; sautes d’humeur ; tristesse constante ; perte de confiance en soi ; sentiments de culpabilité et de honte ; difficultés de concentration ; trop ou trop peu d’appétit ; trouble du sommeil (impossible de dormir même quand bébé dort) ; attaque de panique ; peur constante pour le bébé ; peur de se faire mal et/ou de faire mal à l’enfant ; colère incontrôlable ; retrait social ; sentiments étranges envers le bébé (« pas ceux que devraient avoir une maman envers son enfant ! ») ; problèmes somatiques à répétition ; impression de devenir folle
Les mamans ne présentent pas forcément tous les symptômes, mais dès le moment où la tristesse ou la colère surpassent largement le bonheur, pendant un trop long moment, il est temps de demander de l’aide autours de vous, que ce soit vos proches, vos amis, des bénévoles ou des professionnels.
Et si vous avez le moindre doute, faites un petit point de situation.
Un dernier conseil important : les dépression post-partum commencent souvent avec des fortes anxiétés pendant la grossesse, que ce soit pour les mères ou pour les pères (dont un article sur la dépression post-partum arrivera bientôt), alors pensez-y et anticipez !
Géraldine Busto, psychologue spécialiste en psychothérapie adulte, périnatalité

Entendre ces mots : « Nous pensons que votre enfant pourrait avoir un trouble »… C’est un moment qui ébranle. Parfois ils viennent d’un pédiatre, d’un·e enseignant·e, parfois ce sont simplement vos propres observations. Quelle qu’en soit l’origine, cette phrase ouvre une zone d’incertitude, faite de questions, d’inquiétude… et d’attente. Et pendant ce temps-là, le quotidien ne s’arrête pas. Les rendez-vous sont lointains, les démarches administratives s’enchaînent, les délais dans les centres spécialisés s’allongent. Beaucoup de parents ont alors l’impression d’être laissés seuls, entre deux portes. Pourtant, c’est précisément dans cet entre-deux que le soutien le plus humain — et le plus utile — devrait exister. Car pendant qu’on attend un diagnostic, la vie continue : les rituels du matin, les émotions qui débordent, les incompréhensions, les devoirs, les crises… Et une question qui revient souvent : « On me dit d’attendre… mais comment j’aide mon enfant maintenant ? » « J’ai peur de mal faire, mais je ne veux pas rester passive. » Ces paroles, je les entends régulièrement. Elles révèlent un besoin simple : être accompagné dans l’immédiat, avant même que le parcours médical ne se déploie. C’est là que la neuropédagogie trouve tout son sens. Elle ne remplace ni le diagnostic, ni les professionnels de la santé. Elle offre un soutien concret pendant cette période d’incertitude — un espace où comprendre, ajuster, agir. Grâce à la neuropédagogie, les parents peuvent : mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant : ses forces, ses besoins, sa sensibilité ; mettre du sens sur des comportements déroutants ; découvrir des outils simples pour apaiser les tensions et soutenir les apprentissages au quotidien ; retrouver confiance en leur rôle, car un parent rassuré offre déjà un cadre plus sécurisant. Chaque enfant est unique, chaque famille l’est aussi. La neuropédagogie n’a pas pour vocation d’étiqueter, mais d’éclairer. Elle transforme les doutes en repères et les inquiétudes en petites actions qui changent réellement la journée. Parce qu’un enfant ne peut pas attendre pour être compris. Et qu’un parent soutenu devient, presque immédiatement, un point d’ancrage précieux pour lui.

Et si vous preniez une soirée rien que pour vous deux ? Le vendredi 13 février 2026 Mum to be vous propose un atelier massage en couple. Vous apprendrez les gestes simples pour masser votre partenaire, relâcher les tensions et vous reconnecter dans un moment de douceur. Une parenthèse pour sortir du quotidien, retrouver le contact, la tendresse et simplement être ensemble. Vendredi 13 février 2026 - 19h à 21h, chez Mum to be, CHF 100.- par couple. / Inscription : mumtobesarl@gmail.com