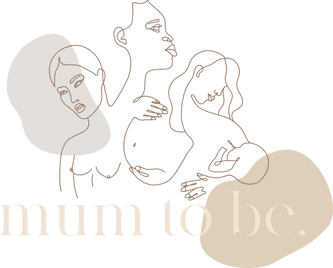Devenir parent : une nouvelle place dans la famille élargie
29 septembre 2025
Devenir parent, ce n’est pas seulement accueillir un enfant : c’est aussi trouver une nouvelle place dans sa famille, parfois même dans toute une lignée. Quand un bébé naît, c’est tout un monde qui se réorganise.
Prenons l’exemple d’une femme qui devient mère. Symboliquement, elle succède à sa propre mère dans la chaîne des générations. Elle entre dans un rôle qu’elle a observé toute sa vie, mais qu’elle n’avait encore jamais vécu de l’intérieur. Pour l’homme qui devient père, le mouvement est semblable : il se retrouve en écho avec la figure de son propre père, consciemment ou non.
Et puis, il y a la découverte du partenaire dans ce rôle inédit. Le couple se transforme : d’abord conjugal, il devient aussi coparental. Celui ou celle qui était un compagnon amoureux devient, on l’espère, un partenaire parental solide, présent et soutenant.
Quand le système familial se réorganise
En psychologie systémique, la famille est vue comme un organisme vivant, en constante évolution. L’arrivée d’un enfant est un bouleversement majeur : les enfants deviennent parents, les parents deviennent grands-parents, les frères et sœurs deviennent oncles et tantes. Chacun change un peu de place.
Cette réorganisation ne se réduit pas à un simple changement de titres. Elle réactive aussi souvenirs, images et émotions. Certains y trouvent une continuité rassurante, d’autres ressentent des tensions, comme si des blessures anciennes ou des attentes familiales refaisaient surface au moment de la parentalité.
Les transmissions invisibles
Nous héritons tous de notre histoire familiale. Les psychologues systémiciens parlent de loyautés invisibles : ces fidélités silencieuses qui nous poussent à répéter certains schémas. Elles se transmettent parfois à travers des gestes, des manières d’éduquer, des valeurs… ou au contraire par des silences et des secrets.
Mais devenir parent, c’est aussi une occasion de liberté. Chacun peut choisir de garder ce qui l’a nourri, transformer ce qui a pesé. Chaque parent devient alors un passeur : entre l’héritage reçu et l’avenir qu’il souhaite offrir à son enfant.
Entre héritage et création
Devenir parent, c’est se tenir à un carrefour : on reste l’enfant de ses propres parents tout en devenant le parent de son enfant. Cette double appartenance peut sembler paradoxale, mais elle invite à des questions essentielles :
• Qu’ai-je envie de transmettre ?
• Qu’est-ce que je préfère transformer ou arrêter ?
• Comment trouver ma propre manière d’être parent, sans me sentir enfermé·e par ce que j’ai reçu ?
• Quelle nouvelle relation cela implique-t-il avec mes propres parents ?
Ces réflexions ne sont pas des obstacles mais des passages. Elles rappellent que la parentalité n’est pas seulement une affaire de couches ou de nuits écourtées : c’est aussi un chemin intérieur, une mise en lien entre les générations.
Trouver sa propre place
Devenir parent, ce n’est pas être parfait ni tout savoir faire. C’est avant tout trouver une place qui fait sens pour soi, en équilibre entre fidélité et liberté, entre héritage et création.
Chaque parent compose avec son histoire, ses ressources et ses fragilités. Il n’existe pas une seule bonne manière d’être parent. Mais une certitude demeure : en devenant parent, chacun écrit une nouvelle page de l’histoire familiale. Une page unique, qui relie le passé et ouvre l’avenir.

Entendre ces mots : « Nous pensons que votre enfant pourrait avoir un trouble »… C’est un moment qui ébranle. Parfois ils viennent d’un pédiatre, d’un·e enseignant·e, parfois ce sont simplement vos propres observations. Quelle qu’en soit l’origine, cette phrase ouvre une zone d’incertitude, faite de questions, d’inquiétude… et d’attente. Et pendant ce temps-là, le quotidien ne s’arrête pas. Les rendez-vous sont lointains, les démarches administratives s’enchaînent, les délais dans les centres spécialisés s’allongent. Beaucoup de parents ont alors l’impression d’être laissés seuls, entre deux portes. Pourtant, c’est précisément dans cet entre-deux que le soutien le plus humain — et le plus utile — devrait exister. Car pendant qu’on attend un diagnostic, la vie continue : les rituels du matin, les émotions qui débordent, les incompréhensions, les devoirs, les crises… Et une question qui revient souvent : « On me dit d’attendre… mais comment j’aide mon enfant maintenant ? » « J’ai peur de mal faire, mais je ne veux pas rester passive. » Ces paroles, je les entends régulièrement. Elles révèlent un besoin simple : être accompagné dans l’immédiat, avant même que le parcours médical ne se déploie. C’est là que la neuropédagogie trouve tout son sens. Elle ne remplace ni le diagnostic, ni les professionnels de la santé. Elle offre un soutien concret pendant cette période d’incertitude — un espace où comprendre, ajuster, agir. Grâce à la neuropédagogie, les parents peuvent : mieux comprendre le fonctionnement de leur enfant : ses forces, ses besoins, sa sensibilité ; mettre du sens sur des comportements déroutants ; découvrir des outils simples pour apaiser les tensions et soutenir les apprentissages au quotidien ; retrouver confiance en leur rôle, car un parent rassuré offre déjà un cadre plus sécurisant. Chaque enfant est unique, chaque famille l’est aussi. La neuropédagogie n’a pas pour vocation d’étiqueter, mais d’éclairer. Elle transforme les doutes en repères et les inquiétudes en petites actions qui changent réellement la journée. Parce qu’un enfant ne peut pas attendre pour être compris. Et qu’un parent soutenu devient, presque immédiatement, un point d’ancrage précieux pour lui.

Et si vous preniez une soirée rien que pour vous deux ? Le vendredi 13 février 2026 Mum to be vous propose un atelier massage en couple. Vous apprendrez les gestes simples pour masser votre partenaire, relâcher les tensions et vous reconnecter dans un moment de douceur. Une parenthèse pour sortir du quotidien, retrouver le contact, la tendresse et simplement être ensemble. Vendredi 13 février 2026 - 19h à 21h, chez Mum to be, CHF 100.- par couple. / Inscription : mumtobesarl@gmail.com